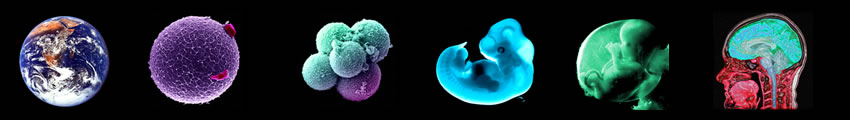LE 2e RENDEZ-VOUS DE LA PSYCHOÉDUCATION
C'est sous le signe de l'humour que s'est déroulé le 2e Rendez-vous de la Psychoéducation en février 2007. Le thème de la journée, "Arrimer la recherche et la pratique: la formation universitaire au banc des accusés", faisait suite au constat du 1er Rendez-vous lors duquel les participants avaient identifié, comme besoin prioritaire, un meilleur arrimage entre la pratique et la recherche dans le cadre de la formation universitaire. Le procès présidé par un trop honorable juge, avec l'aide de quelques avocats, de témoins, d'un jury, d'une assemblée de quelques 150 participants et d'un caporal pour maintenir l'ordre, s'est conclu avec le jugement suivant:
"Mesdames et messieurs de l'audience, mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs qui ont comparu devant nous tous comme importants témoins, Maitres Archambault, Fortin et Corriveau, Caporal Lévesque, et bien sûr, chère Formation universitaire.
 C'est ma responsabilité, en tant que trop honorable juge de la cour, de porter, suite aux tergiversations et aux recommandations du jury et de l'audience. un jugement sur l'importante accusation concernant la formation universitaire. C'est également ma responsabilité que de rendre une décision et de prévoir dans le cas d'une condamnation, une peine.
C'est ma responsabilité, en tant que trop honorable juge de la cour, de porter, suite aux tergiversations et aux recommandations du jury et de l'audience. un jugement sur l'importante accusation concernant la formation universitaire. C'est également ma responsabilité que de rendre une décision et de prévoir dans le cas d'une condamnation, une peine.
L'université est souvent identifiée, par les gens de l'extérieur, de tour d'ivoire du savoir; tour opaque et richissime (du moins au plan intellectuel) réservée à ce que l'on ose parfois appeler la crème ou l'élite de la société. Mais il faut faire attention à ce que cette crème ne tourne pas, ou pire, si vous me permettez l’expression et ce calembour quelque peu douteux je m’en excuse, qu’elle ne devienne épaisse au point d’être imbuvable.
Mais ne rions point. Idéologiquement, l'Université est considérée comme un lieu d'apprentissage et donc de savoir. On estime que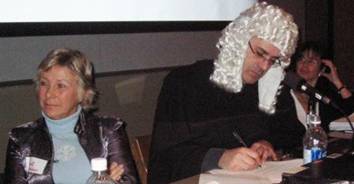 le savoir est nécessaire, qu'il impose le savoir-faire. Oui en effet, le savoir est essentiel, mais il est essentiel uniquement parce qu'il devrait habituellement être suivi d'un apprentissage du savoir-faire. A quoi sert effectivement d'amasser des connaissances qui seront trop tôt entassées sur les tablettes des bibliothèques pour être rapidement couvertes d'un filtre de poussière. Je prends ici les mots de Pascal le mathématicien et philosophe des sciences qui disaient: "Il est peut-être mieux de ne rien savoir et de tout comprendre que de tout savoir et de ne rien comprendre".
le savoir est nécessaire, qu'il impose le savoir-faire. Oui en effet, le savoir est essentiel, mais il est essentiel uniquement parce qu'il devrait habituellement être suivi d'un apprentissage du savoir-faire. A quoi sert effectivement d'amasser des connaissances qui seront trop tôt entassées sur les tablettes des bibliothèques pour être rapidement couvertes d'un filtre de poussière. Je prends ici les mots de Pascal le mathématicien et philosophe des sciences qui disaient: "Il est peut-être mieux de ne rien savoir et de tout comprendre que de tout savoir et de ne rien comprendre".
Cette notion de compréhension nécessairement nous oblige à considérer le savoir-être. Mais cela est-il du ressort de l'Université que de s'attarder au savoir-être? Il semble que oui; certaines unités académiques se sont déjà penchées sur la question et ciblent maintenant, –évidemment pour l'instant bien partiellement mais c'est un début–, l'apprentissage du savoir-être. Je constate, chères avocates, chers témoins et chère audience, par vos commentaires et remarques, que c'est la qualité du savoir qui dicte le savoir-faire et que c'est la qualité du savoir-faire qui inspire le savoir-être.
 |
|---|
Comment l'Université doit-elle réagir? Devant la spécialisation des connaissances scientifiques et cliniques, mais aussi devant l'interdisciplinarité de plus en plus nécessaire et ce savoir qui se dissout sans cesse (car nous en savons toujours plus mais, proportionnellement à l'ensemble des connaissances qui ne cessent de croître et de se diversifier, nous en savons relativement toujours un peu moins), il est compliqué d'offrir aux étudiants une formation qui dépasse la seule acquisition des fondements théoriques.
 La mission pédagogique de l'Université est de promouvoir les capacités de synthèse des étudiants, leur polyvalence et leur capacité de réflexion. L'Université, tout comme la société dans laquelle elle baigne, ne peut se permettre une formation qui, comme une chaîne de montage industrielle, produit des suiveurs qui, bien que capables d'appliquer le savoir appris, n'arrivent pas à innover et à s'interroger sur le savoir et sur le savoir-faire. A cette fin, la formation devrait viser la personne dans sa globalité et cibler toutes ces dimensions inhérentes à la réalité humaine: la dimension intellectuelle bien sûr, mais aussi la dimension sociale et affective.
La mission pédagogique de l'Université est de promouvoir les capacités de synthèse des étudiants, leur polyvalence et leur capacité de réflexion. L'Université, tout comme la société dans laquelle elle baigne, ne peut se permettre une formation qui, comme une chaîne de montage industrielle, produit des suiveurs qui, bien que capables d'appliquer le savoir appris, n'arrivent pas à innover et à s'interroger sur le savoir et sur le savoir-faire. A cette fin, la formation devrait viser la personne dans sa globalité et cibler toutes ces dimensions inhérentes à la réalité humaine: la dimension intellectuelle bien sûr, mais aussi la dimension sociale et affective.
La formation universitaire n'est pas un moule, immuable et identique pour tous. C'est un moule qui peut et qui doit s'ajuster à l'indiv idualité (et non à l'individualisme!), aux expériences de chacun et aux besoins immédiats et futurs de la société. Et tout cela n'est possible que par la présence et l'action des intervenants, de psychoéducateurs/trices qui travaillent en collaboration avec les professeurs et les chargés de cours.
idualité (et non à l'individualisme!), aux expériences de chacun et aux besoins immédiats et futurs de la société. Et tout cela n'est possible que par la présence et l'action des intervenants, de psychoéducateurs/trices qui travaillent en collaboration avec les professeurs et les chargés de cours.
Quelques témoins, très séniors et donc très expérimentés, ont déjà plaidé pour cette condition essentielle à la transformation de la formation universitaire. Permettez-moi ce parallèle qui pourrait en faire sourire quelques uns: il y a plus de 150 ans, Darwin (pas tout à fait un contemporain de nos chers témoins dont la sagesse légendaire dépasse la sagacité de nos temps modernes) démontrait que les moins aptes disparaissaient. Il est temps de suivre ce judicieux conseil et d'évoluer vers une formation universitaire adaptée à la réalité clinique et sociale.
 Mais voilà, l'accusée, notre chère formation universitaire, mérite t-elle un châtiment? Faut-il adopter une approche punitive ou psychoéducative? A vous entendre tous aujourd'hui, je me sentirais ô comment odieux, au risque de déplaire au caporal Lévesque, d'affliger une peine. Ne croyez pas que c'est par pur plaisir charnel que cette tâche m'incombe. Non, ce n'est que par compassion pour cette formation universitaire que je porte à cœur, en fait je devrais dire que je porte dans mon cerveau, que je me dois de rendre mon jugement.
Mais voilà, l'accusée, notre chère formation universitaire, mérite t-elle un châtiment? Faut-il adopter une approche punitive ou psychoéducative? A vous entendre tous aujourd'hui, je me sentirais ô comment odieux, au risque de déplaire au caporal Lévesque, d'affliger une peine. Ne croyez pas que c'est par pur plaisir charnel que cette tâche m'incombe. Non, ce n'est que par compassion pour cette formation universitaire que je porte à cœur, en fait je devrais dire que je porte dans mon cerveau, que je me dois de rendre mon jugement.
 Ainsi, ma décision est relativement simple: je condamne l'actuelle formation universitaire. Mais la psychoéducation étant dans sa jeune adolescence, il faut être plus psychoéducatif et moins punitif. Je propose donc une condamnation, mais une condamnation avec sursis; c'est-à-dire que l'exécution de la peine, qui reste pour l'instant non précisée, est suspendue pour une période de trois ans. Avec toutes les réformes qui ont lieu dans les différents départements, cette période devrait être suffisante pour que des changements majeurs surviennent. Du moins c'est mon souhait et nous pourrons tous le constater dans l'avenir.
Ainsi, ma décision est relativement simple: je condamne l'actuelle formation universitaire. Mais la psychoéducation étant dans sa jeune adolescence, il faut être plus psychoéducatif et moins punitif. Je propose donc une condamnation, mais une condamnation avec sursis; c'est-à-dire que l'exécution de la peine, qui reste pour l'instant non précisée, est suspendue pour une période de trois ans. Avec toutes les réformes qui ont lieu dans les différents départements, cette période devrait être suffisante pour que des changements majeurs surviennent. Du moins c'est mon souhait et nous pourrons tous le constater dans l'avenir.
Je propose donc à tous et à chacun, Mesdames et Messieurs de l'audience, membres du jury, chers témoins, Maîtres Archambault, Fortin et Corriveau, et même Caporal Lévesque, d'être à la fois vigilants et patients, et de se réunir tous dans trois ans, pour un nouveau procès en bonne et due forme."
Votre trop honorable juge
LE 1er RENDEZ-VOUS DE LA PSYCHOÉDUCATION
Le 25 novembre 2005 s’est tenu le 1er Rendez-vous de la Psychoéducation. Organisée par les étudiants et les professeurs de l’École de Psychoéducation de l’Université de Montréal, cette rencontre avait comme objectif de discuter des enjeux actuels et futurs de la profession, en particulier concernant la formation universitaire. Plus de cent-cinquante psychoéducateurs, étudiants, gestionnaires, superviseurs cliniques et professeurs ont répondu à cet appel. La rencontre débuta par une conférence très attendue de M. Marcel Renou, président du secteur psychoéducation de l’OCCOPPQ. Monsieur Renou présenta sa vision de la psychoéducation, en traçant un portrait des membres de l’Ordre et en discutant des responsabilités de tous pour l’avenir de la profession. Les panelistes invités, Mme Françoise Fortin (étudiante au Doctorat en Psychoéducation), Mme Suzanne Manningham (ps.ed., chargée de cours) et M. Michel Janosz (professeur) firent progresser la réflexion en précisant certains enjeux de la profession. La discussion fut poursuivie en sous-groupes afin de circonscrire les besoins prioritaires pour la psychoéducation. En plénière, les besoins suivants furent cernés: 1) Besoin d’un meilleur équilibre ou arrimage entre la pratique et la recherche dans le cadre de la formation universitaire 2) Besoin d’inciter les psychoéducateurs à la formation continue et d’établir les infrastructures le permettant 3) Besoin de mobiliser (entre autres par l’entremise d’événements rassembleurs) les intervenants, les étudiants, les gestionnaires, les chercheurs et les professeurs afin de promouvoir la psychoéducation comme champ de pratique et de recherche.