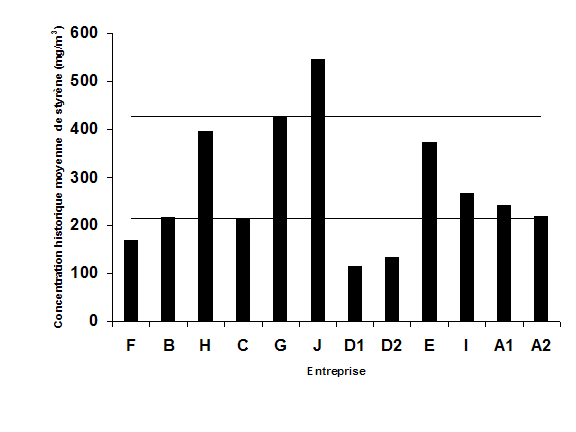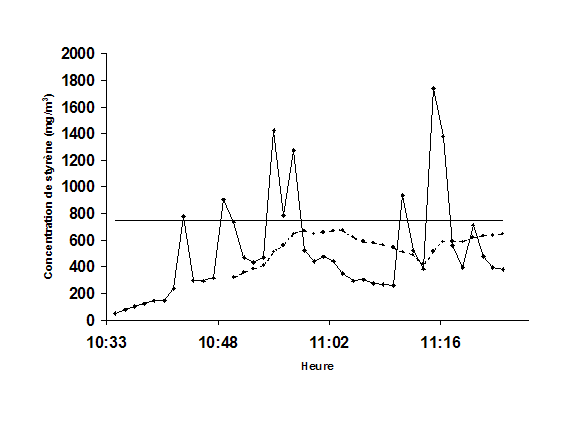Exposition
à des pics de concentration de styrène dans l'industrie québécoise du plastique
armé de fibre de verre
par
Adolf Vyskocil1*, Claude
Viau1, Ross Thuot1, Alice Turcot2 et
Michel Gérin1
1Groupe de
recherche en toxicologie humaine, Département de santé environnementale et
santé au travail, Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville,
Montréal (QC) H3C 3J7
2Direction
de la santé publique de Chaudière-Appalaches, 1000, rue Monseigneur Bourget,
bureau 400, Lévis (QC) G6V 2Y9
*Pour
correspondance, écrire à A.
Vyskocil à l'adresse indiquée
Préparé
pour le cours MSN 6004 en septembre 2003. Version d’un article modifiée afin de
faire ressortir certains aspects rédactionnels à prendre en considération lors
de la préparation d’un manuscrit pour publication. Les étudiants sont priés
d’exercer leur sens critique à l’égard de ce texte, sans tenir compte que trois
professeurs du département sont impliqués dans sa rédaction !
La
version originale et non trafiquée de ce manuscrit a été publiée. Les personnes
accédant à ce texte ne doivent pas en extraire des informations pour un autre
motif que celui de l’apprentissage de la rédaction d’un article scientifique.
Résumé
L'objectif de la présente étude était donc d'examiner les
profils détaillés d'exposition au styrène dans plusieurs usines fabriquant des
produits en plastique armé de fibre de
verre. La fabrication de produits de plastique armé de fibre de
verre peut entraîner, chez les travailleurs, l’exposition à des pics élevés de
concentration de styrène. En effet, en raison des tâches que les travailleurs
accomplissent dans ce secteur d’activité industrielle, il arrive souvent que
pour des périodes plus ou moins longues au cours de la journée de travail les
travailleurs soient exposés à de fortes concentrations de styrène. Ces fortes
concentrations dans l’air ambiant du milieu de travail pourraient se traduire
par des concentrations momentanément élevées au niveau sanguin et, par conséquent,
au niveau du système nerveux central. Un tel profil d’exposition pourrait donc
avoir des conséquences spécifiques sur la neurotoxicité du solvant.
L'exposition de certains travailleurs a été enregistrée "en continu"
dans plusieurs usines lors de l'accomplissement du travail pendant certains
cycles en utilisant un chromatographe en phase gazeuse portatif. Des notes
étaient simultanément prises sur la façon dont le travail était accompli
pendant ces cycles. L'exposition moyenne pondérée sur 8 heures était très variable. L'exposition dépassait la limite, prescrite par la
réglementation québécoise, de 213 mg/m3 dans certaines usines. Certaines valeurs d'exposition mesurées sur la durée d'un cycle
donné excédaient la valeur d'exposition admissible de courte durée de 426 mg/m3.
D'importants pics de concentrations ont été enregistrés dans huit usines, atteignant une
valeur maximale très élevée. La durée de ces excursions à des pics de
concentrations élevés était généralement
assez brève. Dans certains cas, les concentrations de pointe dépassaient largement la valeur d'exposition limite de courte durée malgré le
fait que la concentration moyenne pondérée mesurée sur 8 heures était relativement faible. Cette observation soulève la question de l'impact
potentiel de ces concentrations de pointe sur le système nerveux de
travailleurs. Cet article discute des
implications de ces mesures dans cet important secteur industriel.
Mots
clés: styrène, pics de concentration, profil d'exposition, industrie du
plastique armé de fibre de verre
Introduction
La fabrication de produits de
plastique armé de fibre de verre, tels que des bateaux et des baignoires, peut
s'accompagner d'expositions substantielles au styrène (1-3). Les deux
principales techniques employées dans le
procédé de lamification consistent à déverser la résine manuellement ou avec un
dispositif hydraulique, comme dans le
cas des 10 usines qui ont été visitées dans le cadre de cette étude. Dans le cas du dispositif hydraulique, l'application
peut être réalisée à l'aide d'un pistolet robotisé. Dans l'application
manuelle, la résine de polyester est déposée sur un matelas de fibre de verre
et étalée à l'aide d'un rouleau. Dans l'application hydraulique, un opérateur
manipule un pistolet qui projette des filaments de fibre de verre coupés et la résine sur la
surface d'un moule. Puis, d'autres travailleurs lissent le mélange ainsi étalé
à l'aide de rouleaux. Dans l'un et l'autre procédé, les travailleurs
accomplissent leurs tâches tout près de larges surfaces à partir desquelles de
grandes quantités de styrène peuvent s'évaporer. En effet, au cours de ces
opérations, jusqu'à 15 % du styrène présent dans la résine peut s'évaporer
et se répandre dans l'air du milieu de travail (5). Cela peut représenter des quantités très importantes compte tenu que les
résines employées par les usines de cette étude contenaient jusqu’à 80 %
de styrène.
Au
Canada tout comme dans plusieurs autres pays, il existe des valeurs maximales
d'exposition à plusieurs centaines de substances chimiques rencontrées dans les
milieux de travail. Au Québec, les valeurs d'exposition admissibles au styrène
prescrites par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (6) sont les
suivantes: la valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP) sur huit heures est
de 213 mg/m3 et la valeur d'exposition de courte durée (VECD) est de
426 mg/m3. La VEMP correspond à la concentration moyenne à laquelle
un travailleur doit pouvoir être exposé huit heures par jour et cinq jours par
semaine sans que cela n'ait de conséquences négatives sur sa santé. La VECD est
la concentration moyenne, pendant 15 minutes, qui ne doit pas être dépassée
dans la zone respiratoire du travailleur. Un maximum de 4 épisodes à des
concentrations moyennes de 15 minutes, entre la VEMP et la VECD est permis au
cours d'une journée de travail à condition qu'il y ait des intervalles de 60
minutes entre ces épisodes. Comme nous
le verrons dans cet article, ces valeurs sont souvent dépassées dans les
industries québécoises affectant le système nerveux des travailleurs qui
devraient être mieux protégés par la CSST. Les
limites québécoises sont plus élevées que certaines normes ou valeurs guides
utilisées dans d'autres pays. Par exemple, l'American Conference of
Governmental Industriel Hygienists (ACGIH) (7) recommande une valeur moyenne
pondérée sur huit heures n'excédant pas 85 mg/m3 et une valeur
limite de courte durée de 170 mg/m3. Semblablement, la valeur limite
allemande (8) pour une exposition pondérée sur huit heures (MAK) est également
de 85 mg/m3.
Dans
le domaine de la santé au travail, de récentes revues de la littérature
scientifique ont confirmé que le principal effet résultant de l'exposition au
styrène en milieu de travail est la neurotoxicité (4,5,9-12). Un élément qui mérite toutefois une attention
particulière concerne l'influence de l'exposition à des pics de concentration
de courte durée tels qu'observés dans certaines industries par Pfäffli et
Säämänen (13). Ces pics peuvent
atteindre des valeurs très élevées, ainsi que l’ont observé Geuskens et coll. (14) dans des usines néerlandaises où des pics d'exposition atteignaient
2 500 mg/m3 pour des durées de cinq à vingt minutes. De tels profils d'exposition requièrent donc
l'attention des intervenant en santé au travail quant à leur impact potentiel
sur la neurotoxicité du solvant.
L'objectif de cette étude était
d'établir le profil de concentrations au styrène dans 10 usines de fabrication
d'objets de plastique armé de fibre de verre en mettant l'emphase sur l'analyse
des pics de concentrations observés dans les industries. L'établissement de ces
profils devait aussi servir à sélectionner des populations de travailleurs
devant faire partie d'une cohorte pour une future enquête épidémiologique.
Matériel
et méthodes
Des données sur l'exposition au
styrène ont été recueillies dans dix usines québécoises de petite et moyenne
taille. Ces usines produisent des coques de bateau, des enceintes de douche, des
baignoires, des pièces de camion et d'autobus, des balcons et divers petits
objets. Les produits de plastique armé de fibre de verre sont fabriqués en
utilisant des moules ouverts et un procédé de
lamification par lequel la résine est déversée manuellement ou avec un
dispositif hydraulique.
Les
données concernant le nombre de travailleurs dans chaque usine, le type de
résine employée et la quantité utilisée, les volumes des aires de lamification,
les systèmes de ventilation et les procédés en usage ont été obtenues de la
direction des entreprises et des équipes de santé au travail intervenant dans
ces usines. De plus, des données sur les méthodes de travail ont été consignées
pendant toute la durée de prise des mesures de styrène.
Dans
chaque usine, l'exposition des travailleurs a été suivie au cours de
l'exécution de plusieurs cycles de travail. Un cycle est défini comme une opération ou une tâche exécutée sur une
pièce donnée au cours desquelles la lamification d'une couche ou encore une
opération d'application de la résine est complétée. L'objectif était de recueillir un grand nombre
d'échantillons couvrant un éventail le plus large possible de cycles.
La
concentration de styrène dans la zone respiratoire des travailleurs était
enregistrée en "continu" à l'aide d'un chromatographe en phase
gazeuse portatif relié à un tube flexible de 1,5 m de long (Varian
Chrompack CP-2003,Ville Saint-Laurent, Québec). Le bout de la sonde était
maintenu par un technicien à une distance de 10 à 30 cm du nez du travailleur
pendant toute la durée du cycle observé. Le chromatographe comprenait une
colonne CP sil 5 CB de 10 m
de longueur maintenue à une pression de 207 kPa et à une température de 140°C. La température de
l'injecteur était fixe à 105°C.
Le gaz vecteur était l'hélium. Le signal du détecteur (catharomètre) était
enregistré et traité par le logiciel "Star Chromatography
Workstation" v 5.31 de Varian. L'appareil était calibré selon les
indications du manufacturier à l'aide de mélanges étalons de styrène dans l'air
ambiant libre de styrène à des concentrations variant de 21 à 852 mg/m3,
mais nous avons établi que la courbe standard était linéaire jusqu'à
17 040 mg/m3. Cela nous
a permis de mesurer notamment les pics atteignant 1 781 mg/m3 qui
ont été observés pour 35 % des cycles dans une des usines. Des échantillons étaient analysés en fait toutes les 1,2
minutes pendant toute la durée d'un cycle donné afin d'établir le profil
temporel détaillé de l'exposition au styrène. Des notes détaillées et,
à l’occasion, des photographies étaient prises simultanément sur la façon dont
le travail était réalisé pendant les cycles.
De
manière opérationnelle, un pic de concentration était défini comme une
concentration dépassant, à un moment quelconque au cours d’un cycle, au moins
deux fois la concentration moyenne pondérée sur huit heures la plus récemment
observée pour un travailleur ayant une fonction semblable dans l'usine sous
étude. Cette
définition a été ainsi établie puisque ce rapport de concentrations correspond
à celui qui peut être calculé entre la VECD et la VEMP. La valeur
d'exposition moyenne pondérée sur huit heures dans chaque usine a été calculée
à partir des données d'exposition moyenne préalablement recueillies sur des
périodes consécutives de quatre heures par des équipes de santé au travail des
Centres locaux de services communautaires en utilisant des dosimètres passifs.
Cela signifie que les résultats de deux échantillonnages de quatre heures
étaient combinés pour obtenir la moyenne d'exposition sur huit heures.
Résultats
Parmi
les dix usines étudiées, il y avait cinq usines de faible taille (1 à 7
travailleurs avec exposition directe au styrène qui se dégage de la résine),
quatre usines de taille moyenne (15 à 19 travailleurs exposés) et une usine de
grande taille (45 travailleurs exposés). Ces données apparaissent à la figure 1 et
au tableau 2. Les
usines de faible taille utilisaient entre 60 et 760 kg de résine contenant
du styrène par jour, les usines de taille moyenne en utilisaient entre 320 et 1 050 kg par
jour et la consommation journalière de la grande usine atteignait 3 400 kg par
jour. Le contenu en styrène des résines variait de 20 à 80 % (en poids).
Étant donné les importantes variations dans la taille des produits fabriqués et
dans le rythme de production, les volumes des salles de lamification variait de
380 à 20 000 m3
(figure 1). Les procédés de fabrication étaient généralement semblables
d'une usine à l'autre et les deux opérations majeures étaient soit
l'application manuelle, soit l'application hydraulique de la résine. Deux usines
utilisaient une application robotisée pour la fabrication de certaines pièces.
La lamification des objets
volumineux était réalisée dans des aires spacieuses et ouvertes, sans
séparation physique entre les zones où sont accomplies les diverses opérations.
Souvent, les préposés à la lamification accomplissaient leurs tâches tout près
de l'opérateur appliquant la résine au pistolet hydraulique et ce, au cours de
l'application de celle-ci. Les travailleurs appliquant la première couche de
résine de polyester dans le moule portaient toujours des équipements de
protection respiratoire et leur exposition n'a conséquemment pas été évaluée.
Aucune protection respiratoire n'était utilisée par les autres travailleurs,
dont l'exposition a été évaluée dans cette étude. Dans huit usines, il y avait
extraction d'air par des systèmes de ventilation locale ou générale. Cinq des
usines étaient équipées de systèmes élaborés de ventilation comprenant des
hottes d'évacuation de l'air vicié couplées à des unités de climatisation de
l'air admis. Dans ces usines, les conditions d'exposition hivernale et estivale
étaient les mêmes comme en attestaient les mesures moyennes disponibles des 1 à
4 dernières années (15). Dans certaines cas, on avait adjoint aux systèmes de
ventilation des ventilateurs circulaires à pales qui créaient un déplacement
d'air directionnel.
Le tableau 1 présente un résumé
des caractéristiques d'exposition dans les dix usines étudiées. Ces données
montrent que l'exposition y était très variable, même pour une usine donnée. Les données de l'exposition moyenne
pondérée sur huit heures s'étalaient de 112 à 558 mg/m3, en accord
avec les données publiées par d’autres auteurs (2, 3, 14). Il n'y
avait pas de relation entre la taille de l'entreprise et l'exposition moyenne
observée (figure
2). Les
concentrations d'exposition les plus importantes étaient observées pendant la
lamification de moules de coques de bateau (données non présentées). Une
comparaison des données d'exposition avec les valeurs d'exposition admissibles
(VEMP) montre que de 50 à 100 % des travailleurs échantillonnés dans 6
usines seraient exposés à des concentrations dépassant nettement 213 mg/m3
(résultats dans la référence 15). À
l’époque où les conditions de travail s’améliorent dans plusieurs secteurs
industriels, il est inacceptable que cette situation prévale dans ce secteur
industriel et les mesures correctrices appropriées devraient être prises dans
les plus brefs délais. Dans
deux de ces usines, la valeur d'exposition moyenne pondérée sur huit heures
atteignait presque le double de la VEMP et dans une autre usine, elle
dépassait 2,6 fois la VEMP.
La mesure des profils détaillés
d'exposition au cours des divers cycles montre une grande variation des
concentrations entre les cycles (tableau 1 – pour plus d’informations, le
lecteur est prié de consulter la référence 15). Dans sept usines, certaines des
valeurs d'exposition moyennes calculées sur la durée d'un cycle spécifique
dépassaient la VECD de 426 mg/m3 (dans quatre usines, le dépassement
était de plus de 2 fois la VECD). La durée des cycles allait de 3 à 88 minutes
(tableau 1).
Dans une petite usine (B) et
dans la grande usine (A), aucun pic d'exposition n'a été observé suivant la
définition d'un pic dans cette étude, l'exposition moyenne se situant autour de
la VEMP. Dans
les huit autres usines, des pics atteignaient de 2 à 16 fois la concentration
moyenne la plus récemment observée. La concentration instantanée la plus élevée
qui a été observée atteignait 3 370 mg/m3 (Tableau 1). Cela
représente une absorption de styrène dans qui dépasse momentanément de presque
8 fois la VECD puisque Astrand (16A) a
montré que l’absorption de styrène était indépendante de la concentration et de
la ventilation pulmonaire sur une large plage de valeurs. La
durée des pics variait de 2 à 17 minutes. Bien entendu le fait que les
échantillons étaient analysés toutes les 1,2 minutes a pu influencer la
détermination de la "vraie" concentration de pointe. En effet, avec
le type d’appareillage utilisé, il n’était pas possible d’échantillonner l’air
à une fréquence plus courte que 1,2 minutes de sorte que nous ne disposons pas
de vraies mesures « en continu ».
À titre d’exemple, la figure 3
présente un profil d'exposition typique pour un débulleur au cours de la
lamification d'une coque de bateau dans l'usine E. Dans cette usine, des
bateaux de six mètres de longueur sont fabriqués et seule une ventilation
générale assure un renouvellement de l'air. La concentration moyenne mesurée
sur 8 heures était de 374 mg/m3. Pendant le cycle étudié, la moyenne
mobile, calculée sur 15 minutes, dépassait largement la VECD et les valeurs
instantanées atteignaient 1 800 mg/m3. La concentration moyenne
obtenue pendant le cycle d'une durée de 50 minutes était de 514 mg/m3.
La distance entre la zone respiratoire du débulleur et la surface de
lamification (600 ´ 400 cm) était de 60 cm environ.
Discussion
Cette étude dans l'industrie du
plastique armé de fibre de verre a montré que des concentrations très élevées
de styrène peuvent être atteintes au cours des procédés de fabrication,
confirmant les observations faites dans d'autres pays (2,3,14). Selon les observations réalisées dans le milieu de
travail et qui ne sont pas détaillées dans cet article, lorsque les résultats
sont examinés selon la perspective de l'exposition au styrène des préposés à la
lamification, il apparaît que les expositions les plus fortes surviennent lors
de la lamification de moules de coques de bateau. Les concentrations observées
au cours d'un cycle spécifique (application manuelle ou hydraulique) variaient
peu d'une usine à l'autre, peu importe la taille de ces dernières. Les facteurs
ayant une influence potentielle sur les concentrations observées sont trop
nombreux pour en permettre une analyse statistique raisonnable. Les
observations colligées sur le terrain au cours de l'étude suggèrent toutefois
que les facteurs les plus importants déterminant la concentration d'exposition
globale au styrène pour une usine donnée comprennent: la distance entre la zone
respiratoire du travailleur ne portant aucune protection respiratoire et la
grande surface à partir de laquelle le styrène s'évapore, le contenu en styrène
de la résine de polyester et le type de pistolet applicateur utilisé. De plus, l'occurrence de pics de concentration
dépassant largement la VECD montre que le contrôle des sources d’émission n’a
pas été atteint et qu’une modification du procédé ou une amélioration de
l’élimination à la source s’imposent. À
titre d’exemple, des pics élevés de concentration atteignant 1 781 mg/m3
ont été observés pour 35 % des cycles dans l'usine D, les plus faibles
concentrations moyennes mesurées sur 8 heures y étant de 112 et 116 mg/m3.
Dans cette usine, il y avait une combinaison de ventilation générale et de
ventilateurs à pales rotatives au plafond dans la salle de lamification et une
ventilation locale dans les salles de lamification robotisée. La figure 4 donne
un exemple de profil d'exposition pour l'opérateur du robot dans cette usine.
Au cours d'un des cycles d'opération (66 minutes), une concentration moyenne de
89 mg/m3 a été enregistrée, mais avec des pics à 700 mg/m3.
L'exposition au styrène peut
avoir une influence sur le fonctionnement du système nerveux central. Ce
solvant est facilement et rapidement absorbé par inhalation (4,5). Teramoto et
coll. (16) ont rapporté une rétention moyenne dans l'organisme de 71 % du
styrène inhalé chez des volontaires exposés à des concentrations entre 43 et
639 mg/m3 pendant 6 minutes. L'utilisation d'un modèle
pharmacocinétique à base physiologique décrivant la cinétique du styrène dans
l'organisme suggère que les concentrations de styrène dans le sang veineux et
dans le cerveau augmentent rapidement lors d'expositions de courte durée
correspondant à la durée des pics (16). Dans la présente étude, certains
travailleurs étaient exposés à des concentrations instantanées atteignant
3 770 mg/m3 pendant une durée suffisante pour évoquer la
possibilité d’un effet aigu sur leur système nerveux central. Il n'y a
actuellement pas de données disponibles dans la littérature scientifique sur la
relation quantitative entre les durées ou les concentrations de pointe de
styrène et la neurotoxicité de ce dernier. Geuskens et al. (14) ont observé des
symptômes pré-narcotiques (sensation d'ébriété, étourdissement, perte
d'équilibre) chez des travailleurs exposés à des pics de concentration de
2 500 mg/m3 pour des durées de 5 à 20 minutes.
Dans la présente étude, les
travailleurs de l'une des usines étaient exposés à des pics de concentration
atteignant 1 781 mg/m3 en dépit du fait que la concentration
moyenne pondérée sur huit heures était de 112 mg/m3. Ces résultats
indiquent que même dans des usines où la valeur mesurée d'exposition moyenne
pondérée sur huit heures est inférieure à la VEMP, des pics de concentration
dépassant largement la VECD peuvent se produire.
En conclusion, l'évaluation de
l'exposition au styrène dans dix usines québécoises de fabrication de produits
de plastique armé de fibre de verre montre que plusieurs travailleurs de ces
milieux sont exposés à des concentrations de styrène dépassant les valeurs
d'exposition admissibles selon le Règlement québécois sur la santé et la
sécurité du travail. D'importants pics de concentration ont été observés dans
la majorité des usines étudiées. Dans certains cas, les pics de concentration
peuvent largement dépasser la VECD malgré le fait que la concentration moyenne
pondérée sur huit heures paraît relativement faible. Ces observations soulèvent
la possibilité que des effets systémiques sur le système nerveux central
pourraient survenir chez des travailleurs que l'on pense relativement peu
exposés au styrène si l'estimation de l'exposition ne porte que sur une mesure
pondérée sur huit heures. Il importe donc de procéder à une évaluation
détaillée des profils d'exposition dans cette industrie. De plus, l'impact
potentiel de pics de concentrations élevés de courtes durées sur le système
nerveux mériterait d'être étudié de manière approfondie. Des mesures de
mitigation additionnelles, telles que l'utilisation de résines sans styrène et
la modification des systèmes de ventilation, devraient être prises pour réduire
ces pics d'exposition dans ce type d'entreprises (17-20).
Remerciements
Cette étude a été réalisée
grâce à une subvention de l'Institut de recherche en santé et en sécurité du
travail du Québec. Les auteurs remercient Messieurs Jean-Guy Nadeau (CLSC
Frontenac), Marcel Jacob (CLSC Centre-de-la-Mauricie), Claude Massicotte (CLSC
et CHSLD de la MRC
Montmagny) et Jean-Yves Larouche (CLSC, Service de santé au
travail des Bois-Francs) pour leur contribution technique experte.
Références
- Campagna,
D., Fabriziomaria, G., Mergler, D., Moreau, T., Galassi , C., Cavalleri,
A. et
Huel, G. (1997) Color vision loss among styrene-exposed workers. Neurotoxicological threshold assessment. NeuroToxicology 17:367-374.
2.
Lemasters, G.K., Carson, A. et Samuels, S.J. (1985)
Occupational styrene exposure for twelve product categories in the
reinforced-plastics industry. AIHAJ
46:434-441.
3. Schumacher,
R.L., Breysse, P.A., Carlyon, W.R., Hibbard, R.P. et Kleinman, G.D. (1981)
Styrene exposure in the fibreglass fabrication industry in Washington State. Am. Ind.
Hyg. Assoc. J. 42:143-149.
4.
VYSKOCIL,
A., GÉRIN, M., VIAU, C. et BRODEUR, J. (1997a) Relation entre l’exposition
au styrène et les effets à la santé – Analyse critique de la littérature. Travail
Santé 13 : S10-S14.
5. Vyskocil, A., Viau, C., Brodeur, J.
et Gérin, M .(1997b) Relation entre l’exposition au styrène et les effets à la
santé – Analyse critique de la littérature. Montréal:
Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, B-053, 138
p.
6. Gouvernement du Québec (18 juillet
2001) Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Gazette officielle du
Québec, Partie 2, Lois et règlements 133(29):5020-5133.
7.
ACGIH (1999) Documentation of the
TLV. American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Cincinnati, OH.
8.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (1998)
MAK and BAT Values 1998. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim
9.
H. Greim et G. Lehnert (1999/2000) Styrene.
In Biological exposure values for occupational
toxicants and carcinogens. Criterial data evaluation for BAT and EKA values,
vol.3. Wiley-VCH-Verlag, Weinham.
10. Kishi, R., Tozaki, S.et Gong, Y.Y. Impairment
of neurobehavioral function and color vision loss among workers exposed to low
concentration of styrene – A review of literatures. Industrial Health 38: 120-126, 2000.
11. Rebert, C.S. et Hall, T.A.(1994) The
neuroepidemiology of styrene: A critical review of representative
literature. CRC Critical Reviews in
Toxicology 24: S57-S106.
12. Wolf, K., Bienfait, H.-G., Brohman, P. et
Brucksch, E. (2000) Styrolbelastung von Beschäftigten in der Polysterharz
verarbeitenden Industrie. Arbeitmed Sozialmed Umweltmed 35 : 312-315.
13. Pfäffli, P. et Säämänen, A.(1993) The
occupational scene of styrene. In
Butadiene and Styrene: Assessment of Health Hazards. (Sorsa, M.,
Peltonen, K,, Vainio, H., Hemminki, K., Rédacteurs) p.15-26, IARC Scientific
Publications No. 127. Lyon. IARC.
14. Geuskens, R.B.M., van der Klaauw, M.M., van
der Tuin, J. et van Hemmen, J.J. (1992) Exposure
to styrene and health complaints in the Dutch glass-reinforced plastics
industry. The Annals of Occupational Hygiene
36:47-57.
15. Vyskocil, A., Tardif, R., Viau, C., Carrier, G., Gérin, M.,
Thuot, R., Ska, B., Rosner, A., Farant, J.P. et Turcot, A. (2002) Effets des
pics de concentration sur la neurotoxicité du styrène dans l’industrie de
plastique renforcé de fibre de verre – Phase I. . Montréal: Institut de
recherche en santé et en sécurité du travail du Québec.
16. Teramoto, K., Horiguchi, S.,
Nakaseko, H. et Kageyama, M. (1992) Initial uptake of organic solvents in the
human body by short-term exposure. Journal of Science of Labour 63:13-9.
16A. Astrand L. (1983) Effect of Physical Exercise on Uptake,
Distribution and Elimination of Vapors in Man. In: Modeling of Inhalation Exposure to
Vapors: Uptake, Distribution and Elimination (Fiserova-Bergerova V, Rédacteur),
107-130, CRC Press, Boca Raton.
17. Andersson, I.-M., Niemelä, R., Rosén, G. et
Säämänen, A. (1993) Control of styrene exposure by horizontal displacement
ventilation. Applied Occupational and
Environmental Hygiene 8 : 1031-1037.
18. INRS (1984) Guide pratique de ventilation 3. Mise en œuvre
manuelle des polyesters stratifiés. Cahiers de Notes Documentaires
114 : 3-23.
19. Kalliokoski, P., Säänaänen, A.J., Ivalo, L.M.
et Kotti, H.M. (1988) Exposure to styrene can be controlled. American
Industrial Hygiene Association Journal 49: 6-9.
20. Lazure, L.P. (2000) Evaluation of a local
exhaust. Applied
Occupational and Environmental Hygiene 15 : 681-685.